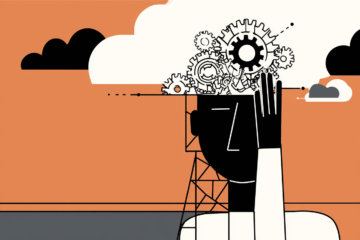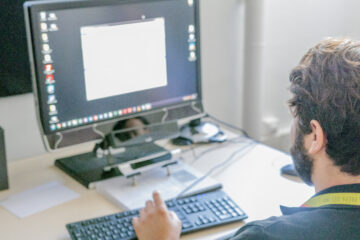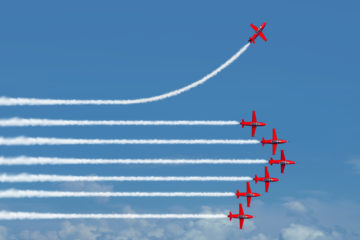Akiani va toujours plus loin dans son intellectualisation de tout et n’importe quoi. Et nous aurions presque dérogé à nos pratiques si nous n’étions pas revenus sur le stimulant jeu qui a animé notre « après-midi team-building » du mois de février : un escape game.
Qu’est-ce que l’escape game ?
Pour rappel, l’escape game est un jeu d’évasion grandeur nature. L’objectif est de réussir à s’échapper à temps d’un espace contenant pleins d’indices. Ces derniers sont dissimulés et mènent progressivement à la clé de sortie.
Nous avons réalisé ce jeu à 5 ! Et nous sommes sortis en 59 minutes et 59 secondes, à temps donc et à une seconde près ! Le taux de sortie de cet escape game est actuellement de 35%, autant dire que nous ne sommes pas peu fiers ! Mais quels sont les éléments déterminants qui nous ont permis de nous échapper à temps ? Quels sont ceux qui nous ont retardés au point d’être passés au plus près de l’échec ?
Ce sont toutes ces questions qui nous mènent à réaliser notre petite enquête.
Ils se basent sur des exercices de logique, de recherche, d’agrégation de données et de transformation de données. Les escape games demandent au groupe d’allouer ses ressources de manière collaborative à la réalisation des tâches précédemment énoncées. Le tout en un temps donné.
Les conditions de jeu demandent également la mise en oeuvre de stratégies cognitives. Les joueurs se retrouvent dans un environnement dont les critères se rapprochent de certaines situations opérationnelles très étudiées sous l’angle des facteurs humains.
(Voir l’étude « The human factor: the critical importance of effective teamwork and communication in providing safe care, M Leonard, S Graham and D Bonacum, 2004 ».)
Alors pourquoi ne pas étudier cette situation et en tirer quelques idées que nous pourrions tester à notre prochain essai afin de sortir plus vite ?
Analyse du déroulement
L’atteinte de notre objectif — sortir de la pièce à temps — demande de la logique, de la patience, de la communication avec ses coéquipiers, etc… Toutes nos compétences individuelles doivent être allouées au groupe de la manière la plus efficiente qu’il soit. Mais quand le temps presse et que chacun veut contribuer à l’atteinte du but, il peut s’avérer compliqué de mettre en place la bonne organisation et la bonne stratégie.

Manque de structuration du groupe
Si nous nous basons sur les théories de gestion de la performance et du risque en situation opérationnelle, nous nous apercevons que nous avons manqué de structuration de groupe. En effet, réaliser une mission en équipe requiert une structuration dépendante de nombreux facteurs jouant un rôle dans la performance du groupe.
La mise en place d’un leadership aurait permis de gérer au mieux la prise de décision aux moments clés. Nous avons en effet failli louper la sortie dans les dernières minutes. Effectivement, la pression temporelle exercée par la minuterie nous a fait perdre nos moyens.
« Nous avons tous échoué dans une tâche plutôt élémentaire (que nous n’expliciterons pas plus afin de respecter la confidentialité du jeu) car nous avons choisi un processus de réalisation très peu efficace, que nous avons même répété plusieurs fois. »
Le choix d’un leader aurait également aidé à maintenir une conscience de la situation partagée : quels sont les nouveaux indices ? qui a déjà fouillé à quel endroit ? combien de temps nous reste-t-il ? comment gérer les indices ?
Untel s’occupe de cette partie donc l’autre de celle qui est à côté. Or il est essentiel que la situation soit comprise et intégrée par tout le groupe. La conscience de la situation doit être la même pour tout le monde. En l’occurrence, nous devons poursuivre le même objectif. Ainsi que nous mettre d’accord sur notre fonctionnement et notamment sur notre vision du processus à opérer pour mener à bien notre enquête.
Apparition d’un phénomène de persévération
Le parallèle peut être fait avec de nombreux cas d’études en aéronautique. Et notamment avec ceux qui s’intéressent au phénomène de persévération. Frederic Dehais s’appuie sur un exemple bien connu en aviation : celui de l’équipage du vol AA-1420 qui a écrasé l’appareil. Malgré des conditions d’atterrissage déplorables et la présence d’autres possibilités plus sures, les pilotes ont persévéré dans leur choix. Ce phénomène de « tunnelisation cognitive » ou « persévération » très étudié dans les situations de gestion de systèmes à risques (centrales nucléaires, avions ) dépend de facteurs sociologiques, psychologiques et neuropsychologiques. Frederic Dehais décrit la persévération comme la focalisation exclusive du raisonnement et de l’attention sur la réalisation d’un but, même si celui-ci est dangereux. (Modélisation des conflits dans l’activité de pilotage, Frederic Dehais, 2004)

Un partage des tâches permet généralement un gain de temps important. Nous nous sommes partagé les tâches. Mais de manière aléatoire sans nous dire « vous vous regardez là-bas et nous ici et après on fait le point ». Non.
« Nous avons été plutôt dispersés, surtout au début où nous avons perdu beaucoup de temps avant de trouver le premier indice. Pourtant, nous avons tous cherché à l’endroit où il était caché mais pas de la bonne façon ».
Nos conseils pour réussir un escape game
Voilà les 2 mesures phare que nous mettrons en place lors de notre prochain jeu d’évasion grandeur nature :
1/ Nommer un responsable
Nous essayerons lors de notre prochain escape game de nommer une sorte de « responsable recherche ». Il aura comme objectif de partager les tâches, d’assurer une communication efficace au sein du groupe et de gérer les ressources en fonction de la contrainte temporelle.
2/ Garder notre calme pour éviter les phénomènes de persévération
L’équipe devra également garder à l’esprit que même à la fin, quand le temps s’écoule, elle devra continuer à analyser toutes les options possibles. Le tout, en tentant de rester le plus calme possible pour éviter les phénomènes de persévération. Cette approche s’inspire des techniques utilisées lors des ateliers de co-conception où la collaboration structurée est essentielle.
Ce sont des objectifs qui peuvent paraître simples mais qui, en situation de stress, sont loin d’être une évidence. Maintenant, il ne nous reste plus qu’à tester nos méthodes inspirées du design thinking !
Et comment évaluer le stress / charge de travail d’un point de vue UX ? N’hésitez pas à consulter nos autres articles sur le sujet.