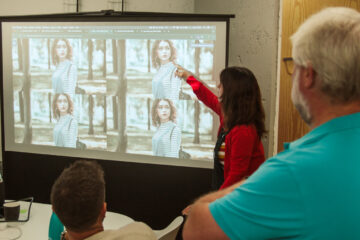Tous les experts des Facteurs Humains et de l’ergonomie s’accordent sur un fait. Une part fondamentale de notre démarche repose sur un travail en profondeur de sensibilisation à la nécessité de prendre en compte le besoin et les contraintes des opérateurs. Une fois ce premier effort fait, il faut ensuite s’attaquer à la question épineuse de l’analyse d’activité pour comprendre l’activité réelle des opérateurs. Par opposition à ce qu’on appelle l’activité prescrite. Aujourd’hui, on parle donc analyse de l’activité, activité réelle et prescrite. Pour illustrer tout ça on parlera de peintures rupestres : celles de Lascaux !
La plus vieille énigme de l’Humanité
Peut-être avez-vous entendu parler de Bertrand David. Son livre La plus vieille énigme de l’Humanité a fait beaucoup parler l’an dernier. Il y développe une théorie concernant les peintures rupestres de la Préhistoire. Dont les très célèbres peintures de Lascaux. Parmi toutes les théories pour expliquer leur réalisation, celle qui était la plus largement acceptée faisait la simple hypothèse d’un dessin au fusain à main levé.
De nombreux éléments intriguaient pourtant les spécialistes. Premièrement : la répétition quasi parfaite de certains modèles. Mais également le fait que certaines peintures commençaient sur des parois pour se finir sur d’autres. Ou bien des dessins parfois caricaturaux, déformés ou encore la superposition sans réelle logique de plusieurs dessins.
Bertrand David est interpellé un soir au coucher de son fils par la projection sur l’un des murs de la chambre d’une figurine posée près de sa lampe de chevet. Il sait que de nombreuses figurines animales ont été retrouvées datant de l’époque préhistorique. Il expérimente et les positionne entre la paroi d’une grotte et une simple lampe à huile. Puis, ce dernier trace les contours de l’ombre portée au fusain et le résultat est concluant !
La figurine se retrouve déplacée, et l’ombre chevauche alors plusieurs parois, il modifie la distance à la bougie et modifie ainsi le facteur d’échelle. Il tourne l’objet et fait alors disparaitre dans l’ombre une partie des membres ou déforme l’ombre portée. Tous les éléments qui intriguaient la communauté depuis si longtemps trouvent alors une réponse. En effet, le simple tracé au fusain de l’ombre portée au mur d’une petite statuette !

Activité prescrite et activité réelle
Revenons à notre question de l’activité. On distingue usuellement ce qu’on appelle les activités prescrite et réelle. L’activité prescrite est celle qui est décrite par les procédures, demandée aux opérateurs. C’est celle qui par exemple dit que le métier d’un(e) employé(e) de caisse est de faire passer des achats devant une caisse enregistreuse, provenant éventuellement d’un tapis roulant et de les faire passer dans une zone de livraison, puis d’assurer la collecte du montant demandé au client. L’activité prescrite, dans notre allégorie, c’est la figurine de Bertrand David. Elle est bien dessinée, définie, comme une fiche de poste décrit, définit un poste de travail. Tout comme un persona aide à définir un utilisateur type.
L’environnement de travail, c’est l’ensemble des contraintes qui viennent impacter l’activité : contraintes sociologiques, physiques, environnementales (luminosité, température…). C’est ce qui va conditionner la transformation de l’activité prescrite en activité réelle. Dans notre allégorie, ce sont les parois de la grotte et la lampe à huile qu’on positionne derrière la figurine. Cette transformation peut être modélisée et explorée grâce à des parcours utilisateurs qui permettent de visualiser cette expérience.
L’activité réelle (effective) est celle qui est effectivement réalisée par les opérateurs. C’est celle qui fait état du fait qu’un employé de caisse est évalué sur des critères de performance, et que la qualité de son accueil en fait partie. Qu’en plus de scanner les achats, il doit par exemple également nettoyer le tapis roulant. Dans le seul but qu’il reste propre si des emballages percés l’ont sali. Pour bien comprendre cette activité réelle, les tests utilisateurs sont essentiels, car ils permettent d’observer directement les comportements.

Étudier en un regard les peintures
Dans notre allégorie, c’est la projection au mur. Elle est déformée, un peu biscornue. Certaines parties sont plus grosses que d’autres. Elle ressemble à la figurine et en même temps si on ne regarde que la figurine, on a une idée fausse de ce à quoi va ressembler son ombre. Si on sait comment est positionnée la lampe et à quoi ressemble la grotte, on peut commencer à s’en faire une représentation, mais il n’y a qu’en regardant l’ombre projetée qu’on saura vraiment. Et qu’on mesurera l’écart avec la statuette bien dessinée du début.
La démarche d’analyse d’activité en ergonomie consiste à étudier en regard trois éléments. Dans un premier temps, mesurer l’écart entre l’activité prescrite et l’activité réelle par rapport à l’environnement de travail. Puis, évaluer l’impact de cet écart et l’effet de l’environnement. Penser analyser l’activité en ne s’intéressant qu’à l’activité prescrite, c’est penser être capable de se figurer la projection sur les parois. Ce n’est pas impossible. Cela demande juste à connaître parfaitement les parois de la grotte et son volume. Mais également la moindre aspérité, la taille de la bougie et les mouvements de la flamme soumise aux courants d’air ainsi que leurs positions relatives à la figurine. Ces observations peuvent être facilitées par des ateliers de co-conception qui permettent de confronter les points de vue et d’enrichir la compréhension.
Que peut-on tirer de cette allégorie des peintures de Lascaux
Ou on peut aller analyser l’activité réelle des opérateurs et réduire le risque que la projection ait très fortement déformé la silhouette initiale, au risque de dégrader la performance, d’impacter la sécurité et de peser sur les coûts. En parlant de peinture, on peut tout aussi bien aborder la partie de créativité. Mais comment vient l’idée créative ? Retrouvez nos articles de blog à ce sujet : le premier et le second épisode.
PS : la théorie a été reprise à des fins d’illustration. Nous devons cependant préciser qu’à sa sortie elle était âprement discutée et critiquée. De nombreux experts doutent du fait qu’elle puisse réellement expliquer les peintures de Lascaux. Car aucune figurine n’y a jamais été retrouvée. Nous voudrions également remercier chaleureusement le Pr. François Daniellou de l’ENSC, qui nous avait présenté le cas de l’employé de caisse dans son formidable cours sur l’activité.